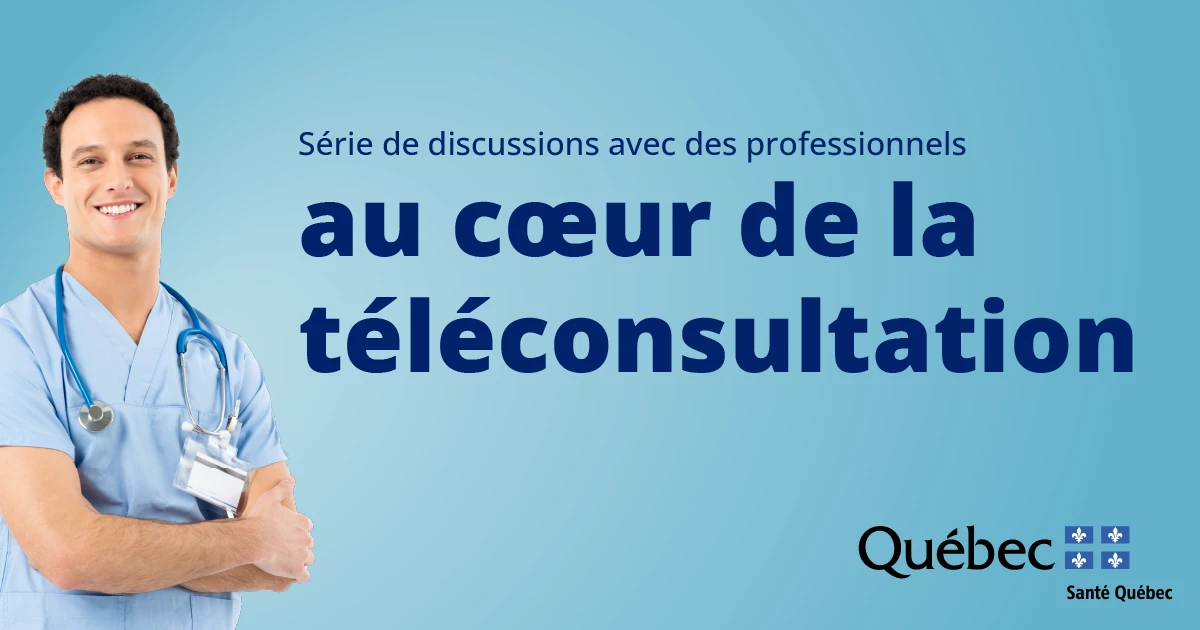Nos entrevues avec des professionnels de la santé nous ont permis de dégager 7 clés pour vous aider à connaître le succès avec la téléconsultation. Les voici :
.01 Identifier les situations appropriées pour la téléconsultation
Il est crucial d’identifier clairement quand la téléconsultation est la plus appropriée et quand une consultation en présence est préférable. Ce discernement permet de garantir que les patients reçoivent le type de soin le plus adapté à leur situation, améliorant ainsi l’efficacité des services et la satisfaction des usagers.
L’efficacité de la téléconsultation dépend de son utilisation judicieuse, en veillant à l’appliquer dans les contextes où elle apporte le plus de valeur.
Découvrez la fiche infographique 03. Ce qu’il faut considérer avant d’opter pour la téléconsultation (PDF 1,1 Mo).
.02 Être accompagné par l’équipe télésanté locale
La travailleuse sociale Karine Lamoureux, le chef de programme Anthonie Grondin et le groupe d’orthophonistes du CISSS des Laurentides ont tous souligné l’importance de l’accompagnement par les répondants clinique et technologique en télésanté. Selon eux, ces experts fournissent un soutien spécialisé indispensable à l’intégration et à l’optimisation des pratiques de télésanté au quotidien.
En outre, le Centre de soutien des services numériques en santé (CSSNS) joue un rôle central en fournissant un soutien essentiel. Il est d’ailleurs à noter qu’en ce qui concerne la téléconsultation, le CSSNS est accessible aussi bien aux professionnels de la santé qu’aux patients.
Pour prendre contact avec le répondant en télésanté de votre établissement, utilisez le formulaire de la page Contacter un répondant en télésanté d’un établissement.
Pour les détails sur les services du CSSNS et pour en connaître les coordonnées, visitez la page Soutien aux cliniciens et professionnels.
.03 Adapter la trajectoire clinique à la téléconsultation
L’intégration réussie de la téléconsultation dans la pratique clinique requiert une adaptation des méthodes de travail. Plutôt que de tenter de reproduire les interactions habituelles du présentiel, il est judicieux de développer des stratégies spécifiques adaptées au virtuel. Cette adaptation demande initialement du temps et des efforts pour modifier les pratiques existantes, mais elle simplifie les processus et augmente nettement l’efficacité des soins par la suite.
En reconnaissant les spécificités de chaque type de soin, les professionnels peuvent pleinement bénéficier des atouts de la téléconsultation. Elle rend les soins plus accessibles, en particulier pour les patients qui peinent à se déplacer.
Pour certains patients vulnérables, quelques clics peuvent être plus faciles que d’ouvrir la porte d’un hôpital.
Découvrez la fiche 05. Les prérequis à la téléconsultation par vidéoconférence (PDF 210 Ko).
.04Saisir l’occasion pour enrichir sa pratique et innover
L’organisation de la trajectoire clinique de la téléconsultation permet de sortir des sentiers battus et d’explorer de nouvelles façons de faire. Par exemple, des professionnels rencontrés organisent désormais des rencontres de groupe avec les parents de jeunes patients beaucoup plus facilement. Ils surmontent ainsi les défis des horaires conflictuels grâce à la flexibilité que permet la téléconsultation.
Elle permet également aux professionnels de partager des ressources éducatives et de former les patients à propos de leurs soins de manière plus efficace et interactive. De plus, cette technologie offre de nouvelles méthodes d’interaction inattendues tels que les jeux adaptés au format numérique pour une clientèle pédiatrique. Ceux-ci favorisent l’engagement des jeunes patients de manière ludique tout en facilitant leur suivi en temps réel.
Ces avancées démontrent comment la téléconsultation enrichit le parcours de soins, rendant les interventions plus accessibles et personnalisées, tout en augmentant la satisfaction des patients et de leurs proches.
C’était un gros choc pour moi, mais j’ai découvert que je pouvais faire des jeux avec des enfants à travers un écran, et ça fonctionne! Certains enfants sont même meilleurs à l’écran qu’en présentiel.
Découvrez la fiche infographique 04. Choisir la vidéoconférence, le téléphone, les communications écrites ou le présentiel (PDF 3,1 Mo).
.05Établir des règles claires et un cadre rigoureux
Pour une intégration réussie de la téléconsultation, il est crucial d’établir une structure et certaines règles précises. Ceci inclut les aspects de consentement et de confidentialité, de même que des protocoles de contingence. Cette structure devrait couvrir également des aspects administratifs tels que la gestion des rendez-vous et le soutien disponible en cas de besoin. La mise en place de processus clairs dès le début favorise une communication efficace et sécuritaire, où les professionnels et les patients se sentent à l’aise et respectés.
Il est essentiel d’établir un cadre de travail strict, même lorsque nous nous retrouvons dans un salon. Les patients doivent comprendre que nous restons dans un contexte professionnel, peu importe l’endroit.
Découvrez les fiches 06. Le consentement aux soins virtuels (PDF 236 Ko) et 07. Les bonnes pratiques en rencontres virtuelles (PDF 161 Ko).
.06Ouvrir la porte de la collaboration avec les partenaires
La téléconsultation s’effectue le plus souvent entre un professionnel et un patient. Cependant, elle facilite également la collaboration avec d’autres partenaires du réseau. L’ajout de partenaires provenant d’organismes locaux et d’autres établissements ou installations de soins peut même représenter un important facteur de succès. Ces collaborations permettent d’élargir l’accès aux soins et d’optimiser les ressources, créant un réseau de soutien solide pour les cliniciens et les usagers. En adaptant ainsi les méthodes de consultation, les professionnels maximisent l’efficacité des outils numériques, rendant les interactions plus fluides.
L’équipe de médecine des toxicomanies du CHUM rapporte avoir mis en place une offre de service utilisant la téléconsultation avec la collaboration d’organismes communautaires. Les responsables du projet sont fiers de pouvoir affirmer que depuis, le taux de participation à leurs services est significativement plus élevé en mode virtuel : ce taux s’élève à 63 % par le biais de la téléconsultation comparativement à 52 % en présentiel.
.07Avoir un « superutilisateur » sur place
Afin de surmonter les barrières initiales et de favoriser une adoption efficace, il est intéressant de pouvoir compter sur un superutilisateur. Il s’agit d’une personne ressource de l’établissement ou de l’équipe qui a une longueur d’avance en termes d’expertise et d’expérience avec la modalité de téléconsultation. Parfois un expert en technologie, d’autres fois un autre clinicien, le superutilisateur joue un rôle essentiel en offrant un accompagnement continu et adapté aux autres utilisateurs. Cela assure une transition plus douce vers ces nouvelles pratiques de télésanté.
Grâce aux superutilisateurs, les membres de l’équipe ne se sentaient pas seuls, ce qui les a aidés à continuer le projet. Ils avaient quelqu’un pour les aider en cas de problème.
Enrichir sa pratique et améliorer l’accès
Les témoignages des professionnels qui ont intégré la téléconsultation dans leur pratique quotidienne révèlent un tableau positif : une fois les ajustements initiaux réalisés, nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas revenir à une pratique exclusivement en personne. La téléconsultation, avec ses nombreuses fonctionnalités et son potentiel d’amélioration de l’accès aux soins, est non seulement un pas dans la modernité, mais une réelle opportunité d’enrichir la pratique clinique.
Nous tenons à remercier les professionnels qui ont généreusement partagé leur temps et leur expertise pour parfaire notre compréhension de la téléconsultation.
- Sylvain Charbonneau (chef Transfert des connaissances et innovation, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)
- Dr Sébastien Chénier (généticien, CIUSSS de l’Estrie-CHUS)
- Sofiane Chougar (infirmier-chef, CHUM)
- Dre Elisabeth Cournoyer (gérontopsychiatre, CIUSSS du Nord-de- l’Île-de-Montréal)
- Anthonie Grondin (chef de programme Santé mentale et dépendance, CISSS de la Montérégie-Est)
- Frejus Kénali (répondant technologique, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)
- Francine Labelle (assistante infirmière-cheffe par intérim, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)
- Karine Lamoureux (travailleuse sociale, CISSS de la Montérégie-Est)
- Dre Stéphanie Marsan (médecin et cheffe médicale du service de médecine des toxicomanies, CHUM)
- Renée Mayrand (orthophoniste, CISSS des Laurentides)
- Rodion Mélenciuc (infirmier, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)
- Véronique Tétreault (orthophoniste, CISSS des Laurentides)
- Julie Vadeboncoeur, Ph.D. (psychologue, CISSS de la Montérégie-Centre)